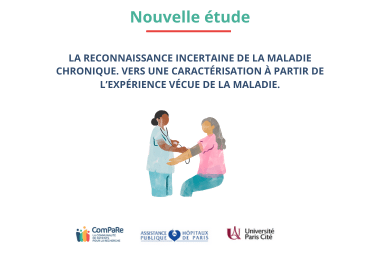Agathe Camus, Marie Gaille et le Pr Viet-Thi Tran ont travaillé sur la “reconnaissance incertaine” du fait de vivre avec une maladie chronique par les patients. En effet, de nombreux patients ne se voient pas comme des malades chroniques. Plutôt que de refléter un déni ou une incompréhension, cette “reconnaissance incertaine” apparaît comme constitutive de l’expérience même de la maladie chronique.
Cet article a été publié en 2025 dans la revue ALTER – European Journal of Disability Research.
Pourquoi avoir mené cette étude ?
Le terme « maladie chronique » regroupe aujourd’hui des affections très variées, du diabète à la sclérose en plaques en passant par l’endométriose ou la dépression et sa signification reste floue.
L’objectif de cette étude était de comprendre comment les personnes concernées vivent et se représentent leur maladie, et de montrer qu’un sentiment d’incertitude dans la reconnaissance de leur état est au cœur de cette expérience.
Comment avons-nous procédé ?
Les chercheuses et chercheurs ont mené 20 entretiens avec des adultes de 26 à 75 ans, souffrant de maladies chroniques très diverses, recrutés dans la cohorte ComPaRe (Assistance Publique–Hôpitaux de Paris).
Les participant·es incluaient des personnes atteintes de sclérose en plaques, Parkinson, diabète, maladie de Crohn, cancers, endométriose, fibromyalgie, insuffisance rénale, ou encore Covid long.
Les entretiens ont exploré leur parcours de vie, leur relation aux soins, et la manière dont ils ou elles se définissent par rapport à la maladie.
Quels sont les résultats ?
Beaucoup de participant·es ne se reconnaissaient pas comme « malades chroniques », même après des années de diagnostic.
Certain·es disaient « avoir une maladie » sans se sentir « malades » ; d’autres changeaient de perception selon les périodes, les symptômes ou leur état psychologique.
Cette reconnaissance incertaine n’est pas un refus de la maladie, mais une partie intégrante de la vie avec elle.
Elle s’explique notamment par les temporalités complexes des maladies chroniques : alternance de crises et d’accalmies, traitements lourds, évolutions imprévisibles.
La frontière entre maladie, handicap et vieillissement apparaît souvent floue.
Les auteurs proposent la notion d’« expérience chronique » pour décrire cette réalité faite de continuités, de ruptures et d’ajustements permanents.
En conclusion
Cette étude montre que vivre avec une maladie chronique, c’est composer avec une incertitude permanente : sur son état, son identité, ou la manière dont les autres nous perçoivent.
Loin d’un simple déni, cette incertitude fait partie de l’expérience même de la chronicité.
En introduisant la notion d’« expérience chronique », les auteurs offrent une nouvelle manière de penser la maladie : non plus seulement comme une durée ou un diagnostic, mais comme une façon de vivre dans le temps, entre santé et maladie, entre normalité et différence.